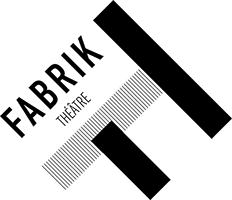« L’Eden Cinéma », retour sur la jeunesse de Duras
par Thomas Flagel

Médiapart / BALAGAN, LE BLOG DE JEAN-PIERRE THIBAUDAT
Le bruit des mots de « L’Eden Cinéma » orchestré par Christine Letailleur
Par Jean-Pierre Thibaudat , publié le 10 FÉVR. 2020
Ensorcelée par la langue de Marguerite Duras, Christine Letailleur met en scène les mots et les silences de « L’Eden Cinéma », adaptation libre et libérée de son premier roman « Un barrage contre le Pacifique ». Ecoutez, imaginez : « On aurait dit qu’elle ne me connaissait déjà plus. Mais son odeur était là, celle de la plaine »….
![]() Scène de « L’Eden cinéma » © Jean-Louis Fernandez
Scène de « L’Eden cinéma » © Jean-Louis Fernandez
Vingt sept ans après avoir publié son premier roman Un barrage contre le Pacifique, Marguerite Duras en écrit une adaptation libre sous le titre L’Eden Cinéma. Libre et comme libérée. Une fidélité dans la rupture comme ce fut le cas du passage fondateur des Viaducs de Seine-et-Oise à l’Amante anglaise dont aimait parler Claude Régy.
Au bord de la mère morte
Dans L’Eden cinéma, on retrouve presque tous les personnages du roman et d’abord la mère, Joseph le frère aîné, Suzanne sa petite sœur, et monsieur Jo. On y raconte les mêmes événements : le barrage qui ne tient pas, la vieille Citroën, le Delage, les cigarettes 555, le phonographe électrique, le diamant avec son crapaud, l’amour fou de monsieur Jo pour Suzanne, l’impossible mariage, le rêve inassouvi de la mère, le départ du frère, le dépucelage de Suzanne, les couchers de soleil sur le Pacifique. Je me souviens, je n’ai rien vérifié. Comme L’Eden se souvient du Barrage.
C’est la même histoire mais autrement. Des mots dits et des didascalies. Un voyage qui commence après la mort de la mère et flotte dans le temps, accompagné par la musique de Carlos d’Alesio. Le temps est celui du reflux, de la mort vers la vie d’avant.
La mère avait travaillé dix ans comme pianiste à L’Eden cinéma, économisant ce qu’elle allait perdre en un jour où le barrage construit pour irriguer les terres arides sera emporté par la mer. La mère est comme fixée à jamais sur l’horizon de cet échec. Le cinéma est plus présent que dans le roman avec ses films muets, il est le lieu-dit du mirage.
Suzanne et Joseph racontent, la mère est le plus souvent assise, comme une morte qui s’attarde un peu dans le monde des vivants, ce pays étranger où elle vit avec ses enfants dont elle perd petit à petit le contact hormis celui des mains, cette ultime parole, abandonnant ce monde où son rêve inassouvi perdurera jusqu’à la fin des temps. A la fin de la pièce, elle mourra une nouvelle fois. Le temps durasien est fait de ces glissements entre les temps , hier est aussi aujourd’hui. Dans la mise en scène à infusion lente qu’en donne aujourd’hui Christine Letailleur, Eden cinéma est un théâtre sans images ou presque où les voix (leurs ton, leur timbre, leurs silences) en disent plus que les corps qui sont comme leurs faire-valoirs.
Le diamant et le crapaud
Claude Régy, le premier, avait mis en scène L’Eden cinéma au défunt Théâtre d’Orsay. Christine Letailleur se souvient de cette mise en scène qu’elle n’a pas vue. Et moi non plus. A un journaliste qui l’interviewait, Régy eut ces mots: : « Voilà, on ne voit rien pour voir tout. C’est-à-dire qu’on s’est aperçu avec Marguerite Duras que le texte, quand il était bien écrit, ça c’est moi qui le dit, évoque beaucoup plus que n’importe quoi qu’on peut montrer sur une scène, que justement les tropiques, la mousson, la famine, les rizières, l’envahissement des marais, l’écroulement des barrages, tout ça est impossible vraiment. ». En écho, dans le livret donné aux spectateur, Christine Letailleur cite cette phrase de Duras extraite d’un entretien avec Leopoldina Pallotta : « je crois parfois que toute mon écriture naît de là, entre les rizières, les forêts, la solitude. De cette enfant émaciée et égarée que j’étais, petite blanche de passage, plus vietnamienne que française, toujours pieds nus, sans horaire, sans savoir-vivre, habituée à regarder le long crépuscule sur le fleuve, le visage brûlé par le soleil ». Et cite cette didascalie de la pièce qui donne son tempo à sa mise en scène : « Les enfants embrassent les mains de la mère, caressent son corps toujours. Et toujours, elle se laisse faire. Elle écoute le bruit des mots ».
![]()
Scène de « L’Eden cinéma » © Jean-Louis Fernandez
Alors, oui, hors les corps porteurs de voix, il y a rien, presque rien sur le plateau de la petite salle du TNS. Rien qu’un cadre juché sur une estrade où coulissent des panneaux transparents ne figurant rien, ou si l’on veut, vaguement, abstraitement, le bungalow de la famille (scénographie Emmanuel Clolus et Christine Letailleur). Ah si, ,une chaise (une, pas deux), le trône de la reine mère. De même, il suffit de peu de choses pour cadrer chaque personnage : le cigare de Joseph, le rouge à lèvres et les cheveux et les nattes de Suzanne (celle d’aujourd’hui et celle d’avant, seul corps changeant)), le petit sac à main de la mère. Le diamant porteur de rêves et de saleté que l’on l’entrevoit à peine au creux d’une main. Le phonographe tout neuf, à peine ouvert, et déjà emporté en coulisses par Joseph. Les corps circulent au pied du praticable, ils passent au fond, flous, derrière un tulle, vêtus de costumes qui ne font pas costumes de théâtre (beau travail d’Elisabeth Kinderstuth). Seul monsieur Jo (le fils d’un riche du pays ) déshabillant des yeux le corps de Suzanne, a du mal à parler une langue qui n’est pas sa langue maternelle.
C’est à pleurer
La mère : présence lentement massive, voix gorgée de sombres grondements engrangés lors des insomnies nocturnes où ses rêves viennent s’échouer, les yeux mi clos comme ceux des reptiles, un port de reine sans royaume, Annie Mercier dans sa splendeur. Le frère, nerveux, fort en gueule, cisailleur d’ambiance, bête en rut, rire en coin, à la fois bagarreur, macho et fiston à sa môman, Alain Fromager, fier mangeur de tête de veau. Cheveux et traits tirés de femme balafrée par la vie, jeune fille svelte, un rien coquine qui n’attend rien des hommes puisque Suzanne en a un qu’elle aime depuis toujours (son frère), robes légères propice au désir, nattes de petite fille qui n’en est plus une, Caroline Proust, fine et troublante Ramona des rizières au parler clair et ferme. Et le natif, Monsieur Jo, dont le mal d’amour tirebouchonne les mots pour mieux les tordre de douleur, fils à papa qui place l’héritage au dessus de la femme aimée découvrant, sonné, les limites du capitalisme ( la beauté n’a pas de prix et tout ne s’achète pas), le Japonais Hiroshi Ota, ambassadeur à l’élégance froissée des scènes asiatiques.
A la fin, il n’y a plus personne. Alors, le ciel se renverse. C’est à pleurer.
Christine Letailleur dirige avec une poigne bienveillante tout ce monde là. Elle avait déjà travaillé avec Hiroshi Ota, déjà Duras, Hiroshima mon amour avec la regrettée Valérie Lang. Claude Régy, le créateur de L’Eden cinéma, s’était pris d’une passion tardive pour le Japon et les acteurs japonais. Il serait beau et juste, ne serait-ce qu’en souvenir de lui, que L’Eden cinéma de Christine Letailleur et de ses acteurs , puisse offrir ses sortilèges au public japonais.


Les Echos
« L’Eden Cinéma » : les fantômes du Pacifique
Philippe Chevilley / Chef de Service | Le 07/02 à 17:30
Au TNS, la metteure en scène Christine Letailleur signe une version onirique et sensible de la pièce de Duras, adaptée de son roman « Un barrage contre le Pacifique ». De grands sentiments, de l’épique, comme au cinéma… et un beau quatuor de comédiens, dominé par la sublime Annie Mercier.
Dans « L’Eden Cinéma », il y a presque tout Marguerite Duras. Adaptation (par elle-même) de son oeuvre fondatrice de 1950, « Un barrage sur le Pacifique », la pièce raconte son enfance dans l’ex-Indochine : le combat insensé de sa mère pour sauver leur concession de la montée des eaux,
le bouillant amour fraternel et sa liaison avec l’amant chinois. Ecrit vingt-sept ans après le roman, le texte cultive le style durassien de la maturité, tout en conservant la fraîcheur des débuts. Il fait feu de tout bois : monologues, répliques courtes, voix off… le tout découpé en séquences – le cinéma y est omniprésent, pas seulement dans son titre (évoquant l’établissement dans lequel la mère travailla un temps comme pianiste). En deux heures chrono, Christine Letailleur en livre une version à la fois limpide et sensible au Théâtre national de Strasbourg. L’entreprise s’annonçait périlleuse. « L’Eden Cinéma » est un huis clos à ciel ouvert où quatre personnages déboussolés sont confrontés à la sauvagerie des éléments et à l’histoire en marche (la fin des colonies). Le drame intime prend une dimension épique quand il se déploie dans les marais inondés et les rues de Saïgon en fusion. Avec la complicité du scénographe Emmanuel Clolus, Christine Letailleur a créé un espace mouvant en clair-obscur, hommage au cinéma.
Le velum en fond de scène et la cloison translucide surélevée (représentant le bungalow familial) forment un double écran, qui s’anime d’images de film, de lumières oniriques et d’ombres chinoises. La bande-son (bruits de vague, « Ramona » et autres « india songs ») est à l’avenant. La metteure en scène met en relief les sentiments exacerbés de ces héros malheureux, irradiés de désir et de frustration. La dimension politique de la pièce n’est pas occultée : la dénonciation d’un système colonial français corrompu claque comme un fouet. La mère mourante lit sa dernière lettre à l’administration – qui l’a flouée en lui vendant des terres incultivables – comme un manifeste rebelle, appelant les damnés de la terre inondée à se révolter. Dans ce rôle, l’immense Annie Mercier touche au sublime, alliage explosif de folie, d’opiniâtreté et de tendresse.
Equilibre
Les trois autres comédiens ne sont pas en reste. Alain Fromager campe un frère ardent (Joseph), avide de liberté. Caroline Proust a l’énergie magnétique, les accents adolescents (parfois un peu forcés) de la jeune Suzanne, alias Marguerite. Le Japonais Hiroshi Ota incarne avec élégance et
retenue l’amant, M. Jo. Malgré quelques emportements superflus, le quatuor parvient à maintenir le bon équilibre entre passion et distanciation.
En poussant délicatement les portes de « L’Eden Cinéma », Christine Letailleur a réveillé les beaux fantômes du Pacifique de Marguerite Duras.
Sceneweb.fr
Christine Letailleur dresse le théâtre contre le Pacifique
8 février 2020 par Anaïs Heluin

© Jean-Louis Fernandez
Après Hiroshima mon amour en 2009, Christine Letailleur renoue avec l’écriture de Marguerite Duras. Avec la grande Annie Mercier dans le rôle de la mère, sa mise en scène de L’Éden Cinéma nous mène droit dans le Pacifique durassien.
Réécriture pour la scène d’Un barrage contre le Pacifique par Marguerite Duras elle-même en 1977, L’Éden Cinéma porte de nombreuses traces de l’écriture romanesque qui l’a précédée de vingt-sept ans. Le récit, déjà, est le même : on y suit le quotidien de Suzanne, de son frère Joseph et de leur mère, Marie Donnadieu, en Indochine française. Les vaines tentatives de cette femme pour éviter l’inondation de sa parcelle de terre, qui lui a coûté dix ans d’économie et une partie de sa santé mentale, y apparaissent comme un leitmotiv. Les nombreuses didascalies de la pièce, ainsi que les longs monologues qui s’invitent souvent au milieu d’échanges plutôt brefs, portent aussi une trace du roman écrit en 1950. En plus de la langue unique de Duras, qu’elle a déjà abordée en 2009 avec Hiroshima mon amour, c’est cet hybride qui a décidé Christine Letailleur à monter L’Éden Cinéma. En route pour le Pacifique.
« Je me souviens qu’à la lecture de L’Éden Cinéma, j’avais été complètement subjuguée par la forme du texte, je la trouvais audacieuse. Duras bouscule les frontières, elle nous fait voyager entre théâtre, cinéma et littérature », analyse la metteure en scène associée au Théâtre National de Strasbourg où a été créée sa pièce. Pour rendre sensible ce mélange des genres, elle met l’acteur au centre d’un dispositif assez simple : un écran qui ne diffusera rien d’autre que des couleurs, et une scène en bois posée au milieu du plateau, telle une esquisse du bungalow où vivent les trois personnages principaux de la pièce. Sur cette plateforme se dressent d’autres écrans, coulissants ceux-là, qui créent un effet de profondeur, de mystère.
Pas un signe des tropiques, dans cet Éden Cinéma. Pas plus que de la pauvreté de la famille, ou encore des barrages, réels et mentaux, construits par mère pour éviter de sombrer tout à fait dans le désespoir. L’Indochine de Marguerite Duras est pourtant bien présente dans cet Éden Cinéma : elle loge avant tout dans les mots, portés Annie Mercier (la mère), Caroline Proust (Suzanne), Alain Fromager (Joseph) et Hirosho Ota (Mr Jo, un riche planteur du Nord qui aime ou croit aimer Suzanne, mais ne peut l’épouser du fait de sa trop basse situation sociale). Christine Letailleur ne pousse toutefois pas la disparition du jeu au point d’un Claude Régy, qui montait la pièce en 1977 avec Madeleine Renaud, Bulle Ogier, Michaël Lonsdale et Jean-Baptiste Malartre. Il y a tout de même du corps dans ce nouvel Éden Cinéma, qui s’active en une mécanique souvent déréglée, dont la fin ne laisse aucun doute.
Chaque interprète a sa manière bien particulière de s’emparer du verbe durassien. Avec son timbre profond et sa manière de casser les phrases à des endroits inattendus, Annie Mercier est la grande cheffe des voix tragiques dont la solitude est immense malgré les nombreux dialogues qui les unissent. Peut-être même à cause d’eux. Elle se déplace peu, lentement, et embarque toujours avec elle une ironie, un humour qui est son barrage personnel contre le pathos. Son jeu ambigu, à la fois intense et distant, révèle tout du statut de son personnage avant même qu’il soit éclairci. Dans L’Éden Cinéma, Suzanne et Joseph qui assument ensemble la narration sont adultes ; si leur mère est vivante dans les souvenirs qu’ils évoquent ensemble, on apprend qu’elle est maintenant décédée.
Caroline Proust excelle dans le passage d’un âge à l’autre. Aussi convaincante en enfant effrontée, éprise de liberté, qu’en Suzanne mature et plus résignée, elle forme avec Alain Fromager un duo contrasté. Ce dernier est en effet un Joseph dont la colère s’exprime par les gestes autant que par les mots. Contrairement à Hirosho Ota, qui est un Mr Jo dont le corps ne trahit rien de la douleur qu’il formule à chacune de ses visites au bungalow. Cette variété d’interprétation a l’avantage de donner à voir la complexité de l’écriture durassienne, sa manière de rassembler les genres et les registres pour échapper à chacun. Elle a par contre tendance à empiéter sur sa part d’étrange, sur ses silences qui épaississent la tragédie et lui donnent une dimension métaphysique. Mais tout Duras tient rarement en une seule pièce, et cet Éden Cinéma en est une preuve réussie.


DNA
Politique Eden Cinéma
Par

Le Monde
Théâtre : un double voyage dans la mer de mots de Duras
Par Fabienne Darge Publié le 12 février 2020 à 10h30