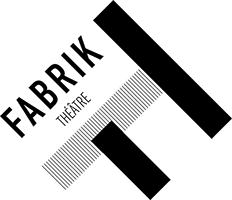Mourir d’amour avec Julie de Lespinasse
Par Jean-Pierre Thibaudat , publié le 28 avril 2022
Christine Letailleur poursuit son roman d’amour avec les écritures du XVIIIe siècle en mettant en scène sa propre adaptation de Julie de Lespinasse, – sa vie, ses lettres d’amour sublimes – amie de D’Alembert et Condorcet. Une fête déchirante portée par Judith Henry. C’est le début lettre écrite, un jour de 1776, à six heures du soir, par Julie de Lespinasse, quelques mois ou semaines avant de mourir à 42 ans (d’amour et de tuberculose), une lettre adressée à celui qu’elle aime.

« Je ne veux pas, mon ami, que, dans le peu de jours qui me restent à vivre, vous puissiez en passer un sans vous souvenir que vous êtes aimé à la folie par la plus malheureuse de toutes les créatures. Oui, mon ami, je vous aime. Je veux que cette triste vérité vous poursuive, qu’elle trouble votre bonheur [ le destinataire, le comte de Guibert, son cadet de dix ans ,vient de se marier] ; je veux que le poison qui a défendu ma vie, qui la consume, et qui sans doute la terminera, répande dans votre âme cette sensibilité douloureuse, qui du moins vous disposera à regretter ce qui vous a aimé avec le plus de tendresse et de passion. Adieu mon ami. Ne m’aimez pas, puisque ce serait contre votre devoir et contre votre volonté ; mais souffrez que je vous aime et que je vous le redise cent fois, mille fois, mais jamais avec l’expression qui répond à ce que je sens ».
Julie écrira encore d’autres lettres à l’homme qu’elle aime jusqu’à ces derniers mots sentant sa fin imminente : « si je revenais à la vie, j’aimerai encore à l’employer, à vous aimer, mais il n’y a plus de temps ». C’est l’épouse de l ‘homme aimé par Julie de Lespinasse qui, découvrant ces lettres et leur incandescence, ne les jettera pas au feu, mais les fera éditer en 1809.
On comprend que Christine Letailleur cette amoureuse des écritures du XVIIIe siècle, après Laclos et Sade et avant, un jour, Restif de la Bretonne, ait eu envie de frayer un bout de chemin amoureux avec Julie de Lespinasse. Son spectacle entrelace subtilement ses lettres et sa vie romanesque. Fille naturelle d’une comtesse (son père étant le mari de sa sœur), elle restera dix ans auprès de madame du Deffand (sa tante naturelle), introduite dans son fameux salon avant d’en être chassée (jalousie). Elle ouvre alors son propre salon fréquenté par les Encyclopédistes et bien d’autres. Très proche de son aîné de quinze ans d’ Alembert, qui l’aima d’un amour platonique et vivra auprès d’elle, Julie de Lespinasse connut un premier amour partagé avec un espagnol, M. de Mora qui, plus tard, mourra avant elle de la tuberculose. Elle aime bientôt follement, plus qu’il ne l’aime, le comte de Guibert, de dix ans son cadet, qui parcourt l’Europe, tire gloire d’un écrit militaire et finit par se marier avec une autre, de moins de vingt ans, au grand dam de Julie qui en a le double.
Dans la mise en scène tout en finesse de Christine Letailleur, Guibert n’apparaît pas en scène autrement qu’en voix off (Alain Fromager) et par les lettres que lui adresse Julie, déployant entre eux un jeu ambivalent de la présence-absence. Seul apparaît furtivement auprès d’elle le spectre de M. de Mora qui lui l’aima tant et plus jusqu’à la mort, le rôle étant (bien) tenu par Manuel Garcie Kilian que l’on a souvent vu dans les spectacles de Christine Letailleur.
L’espace nu presque abstrait est comme mental, excepté quelques bougies (cet adjuvant à l’écriture au XVIIIe siècle). Au centre du plateau, une méridienne entourée de rien, comme une île (scénographie Emmanuel Clolus et Christine Letailleur) où, en marge du monde, habite Julie de Lespinasse. C’est là qu’elle écrit ses lettres d’amour comme autant de lettres à la mer, c’est là qu’elle espère, désespère, pleure, veille, s’éveille, écrit, se meurt. Abritée sous une longue robe magnifique ( Elisabeth Kunderstuth), l’actrice Judith Henry, gracile, fragile et déterminée dans la passion solitaire de son personnage, malade (amour, tuberculose) se nourrissant de pilules d’opium, porte les mots vibrants de Julie de Lespinasse avec une juste fébrilité, tempo constant du spectacle, celui sonore d’une lettre que l’on froisse et défroisse pour mieux la relire.
Le journal d’Armelle Héliot
Julie de Lespinasse, une héroïne racinienne
par Armelle Héliot | 2 mai 2022
Christine Letailleur a conçu l’écriture et la mise en scène de l’évocation belle et bouleversante de celle qui anima au XVIIIème siècle un célèbre salon et fit de l’amour l’essence même de sa vie. Judith Henry illumine la représentation qui palpite également avec les apparitions de Manuel Garcie-Killian et avec la voix off d’Alain Fromager.
Emmanuel Clolus que l’on connut il y a des années alors qu’il travaillait auprès de Louis Bercut, que l’on n’oubliera jamais, est l’un des artistes qui accompagnent au long cours Stanislas Nordey. Mais aussi Christine Letailleur qui cosigne les scénographies car, pour elle, le déploiement d’un texte passe par un espace qu’elle visualise en partie.
Pour cette création inspirée de la correspondance de Julie de Lespinasse avec le comte de Guibert, les comédiens sont dans une boîte ouverte au fond par une fenêtre et un passage vers les coulisses de cour. Mais surtout, cette boîte est magique : des tablettes-écritoires apparaissent, des portes s’ouvrent, une cheminée surgit. A la fin, au milieu, il y aura une méridienne, lieu d’abandon, quand ce n’est pas le parquet nu. La plupart du temps, Judith Henry est debout et va et vient, comme prise dans un mouvement qui figure à la fois l’ivresse d’aimer de Julie de Lespinasse et sa souffrance. Son égarement consenti.

Les lumières de Grégoire de Lafond donnent aux parois des teintes changeantes, à dominante de bleus. On demeure dans un clair-obscur avec flammes vacillantes des bougies, contre-jours, atmosphère de réclusion, de recueillement sur le plaisir et la douleur d’être amoureuse. Vers la fin, des nuées d’oiseaux strient les murs qui se transforment, semblent changer de consistance, comme dans un rêve. Des vidéos de Stéphane Pougnand. L’ensemble lumières et images, est très beau.
Beaux le sont les costumes d’Elisabeth Kinderstuth. Strict et élégant, celui de Mora, éblouissante la robe de Julie, qui elle aussi, change littéralement de couleur selon les éclairages : on peut la croire de faille et soie sauvage chocolat, mais elle peut prendre un ton coq-de-roche, comme une flamme…ou taupe quand la lumière est sourde, quand l’âme étouffe.
Julie de Lespinasse –dont Jean-Claude Brisville avait évoqué le destin, auprès de Madame du Deffand, dans L’Antichambre, une de ses très belles pièces- aura passé sa vie à tenir à une certaine distance celui qui l’aimait vraiment, ainsi son aîné de quinze ans, D’Alembert, abandonné par sa mère, comme elle. L’homme illustre, mathématicien et philosophe, gloire de l’Encyclopédie, fréquenta le salon de Madame du Deffand, qui avait fait de Julie sa lectrice avant qu’elle n’ouvre elle-même, à trente-deux ans, en 1764, son propre salon. D’Alembert, saisi par leurs destins de « bâtards », voua à la jeune femme une passion sans espoir. Pour le Marquis de Mora, jeune amant espagnol, il n’en est pas de même. C’est la famille qui empêcha leur mariage et lui en mourut. Le spectre est là, par la dense et douce présence de Manuel Garcie-Killian.

On n’apprécie que peu les micros, d’ordinaire. Mais ici, tout fait sens, l’amplification n’interdit pas chuchotements, confidences, soupirs, abandon et les bouffées de musique, Orphée et Eurydice, notamment, n’en sont que plus troublants.
Christine Letailleur, avec un sens aigu des nuances et des contradictions des êtres, qu’elle mette en scène Choderlos de Laclos ou Marguerite Duras, dirige à la perfection les interprètes, solistes magistraux. Elle n’a pas cherché à saisir toute la vie de Julie de Lespinasse, mais la concision du récit, porté en partie par la voix off d’Alain Fromager, offre à ceux qui ne sauraient rien de cette femme d’exception, se consumant d’amour, recluse, à la fin de sa courte vie, une manière de précipité biographique clair.
Elle est follement amoureuse du Comte de Guibert, jeune officier à la mode, auteur d’un traité sur la guerre, invité dans les cours d’Europe et chez tous les gens de pouvoir, en France. Il a onze ans de moins qu’elle. Elle sait cette passion vouée au malheur. Il se joue d’elle qui a déjà quarante ans, lorsqu’elle le rencontre en 1772, avant la mort de Mora.
Tout cela, Christine Letailleur, reprenant des lettres, mais trouvant les justes accents du XVIIIème pour les lier, parvient à le rendre accessible. L’interprétation de Judith Henry dilate le texte à des accents raciniens. Julie se reconnaissait dans les héroïnes de l’auteur de Phèdre et de Bérénice. C’est une interprétation très délicate et très puissante. Magnifique.


L’œil d’Olivier
Julie de Lespinasse, la première des romantiques
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore | 26 avril 2022
Au TNS, Christine Letailleur redonne vie à l’une des plus brillante salonnières du siècle des Lumières, la fascinante Julie de Lespinasse. À travers sa correspondance, la metteuse en scène invite à une plongée vertigineuse dans le cœur d’une femme passionnée, libre, d’une grande amoureuse, qu’interprète intensément Judith Henry.
Une femme en tenue grand siècle est assise devant un secrétaire à peine stylisé par une planche de bois sortie d’une cloison bleu turquoise. Gracieuse, la main levée au-dessus de sa tête, elle semble perdue dans ses pensées. Elle rêve à l’homme qui a ravi son cœur, le trop charmeur Chevalier de Guibert. Elle l’a dans la peau, dans la chair. Elle se ronge les sangs en attendant sa prochaine missive qui ne vient pas. Elle désespère. Femme de lettres éprise d’amour, de liberté, Julie de Lespinasse (troublante Judith Henry) vit recluse dans son appartement parisien depuis qu’elle a fermé son salon, si prisé par des philosophes, des écrivains, des artistes.
Une femme libre

Rien ne prédestinait la charmante et vive Julie de Lespinasse à devenir la muse des encyclopédistes, un des beaux esprits de Paris. Enfant naturelle de la comtesse d’Albion et du comte de Vichy, elle était vouée à vivre cacher dans quelque maison de province, dans quelque couvent. Séduite par la jeune fille, sa tante paternelle, Mme du Deffand, la prend sous aile, comme dame de compagnie, et lui ouvre les portes des salons parisiens. Brillante, elle en devient l’un des joyaux, volant la vedette à sa bienfaitrice. Spirituelle, intelligence, ardente, elle lie avec Condorcet, Montesquieu, Turgot et Marivaux, entre autres, de belles et profondes amitiés. Son cœur exalté s’offre à d’Alembert, à qui elle inspire une grande passion. Sans attache autre que celle de ses sentiments, elle mène une vie libre protégeant toutefois son honneur de tout scandale.
Une âme romantique

Bien avant Musset, Chateaubriand ou Hugo, Julie de Lespinasse ouvre la voie au romantisme, à la passion dévorante, aux blessures du cœur. Plume incandescente, elle livre dans ses lettres tout ce que son cœur ressent, félicités, folles affections, reproches et jalousie. Vénérée par le Marquis de Mora (évanescent Manuel Garcie-Kilian), un jeune espagnol qui meurt sur les routes de France de la tuberculose en tentant un voyage funeste dans le seul but de la revoir, elle cède aux avances du trop séduisant Guibert. Rongée par la culpabilité, par le doute, tourmentée par le fantôme du bel hidalgo qui hante ses jours, ses nuits, trahie par son dernier amant, qui épouse ailleurs, gloire et fortune, elle se meurt d’amour loin du monde qui l’a tant portée aux nues.
Souffles de vie

Avec beaucoup d’intelligence et de délicatesse, Christine Letailleur esquisse le portrait d’une femme en avance sur son temps. S’appuyant sur la scénographie très épurée qu’elle cosigne avec Emmanuel Clolus, elle offre aux mots de Julie de Lespinasse, à ceux de ses amis, de ses amants un écrin de toute beauté sans afféteries, sans maniérisme. Chaque parole écrite, échangée, chaque pensée, frappe juste, touche au cœur. Entraînant le public au cœur de l’intimité de l’épistolière, au crépuscule de sa vie, la metteuse en scène invite à découvrir tout un monde d’émotion, d’émoi, de trouble loin des tumultes du quotidien.
Une comédienne en état de grâce
On peut bien sûr regretter l’excès de microtage, de sonorisation, qui parfois gomme les reliefs de la passion, de la tragédie sourde qui se joue dans la tête de cette impénitente amoureuse, quelques images vidéo superfétatoires, mais le jeu habité, ciselé et virtuose de Judith Henry suffit à embarquer sur la carte de Tendre. Omniprésente, lumineuse, elle est Julie de Lespinasse réincarnée, fervente, démesurée, une romantique avant l’heure, une femme émancipée intensément moderne…
webtheatre.fr
JULIE DE LESPINASSE DE CHRISTINE LETAILLEUR
Vivre libre bien au-delà de la femme du XVIII ème siècle.
26 avril 2022 par Véronique Hotte

Remémorons-nous les pratiques des salons féminins dix-huitiémistes. Ainsi, le salon de Marie du Deffand accueille Fontenelle, Voltaire, Montesquieu et d’Alembert ; il concurrence le célèbre salon de Marie-Thérèse Geoffrin (1699-1777) que fréquentent , de 1750 à 1777, d’Alembert, Fontenelle et Voltaire, mais aussi Diderot, Turgot, Maupertuis, Helvétius, Rousseau, Raynal, Rameau, Marivaux et Sophie d’Houdetot (1730-1813) dont Rousseau tombe éperdument amoureux.
Julie de Lespinasse (1732-1776) et Suzanne Necker poursuivent ce nouveau modèle, où la conversation débouche sur des débats d’ordre politique, philosophique et artistique. Hormis quelques exceptions, ce sont surtout des hommes qui fréquentent les salons…puis les femmes : soit l’ambiance des salons féminins du XVIII è siècle (Femmes et littérature, une histoire culturelle, sous la direction de Martine Reid. Vol. 1 : Moyen Âge-XVIII è siècle. Gallimard, Folio Essai.)
Fréquenter un salon – forme de communauté favorisant la créativité et le dialogue – a pu favoriser la mobilité sociale, moins dans les rangs de l’aristocratie que dans ceux des représentants de la République des Lettres…. Les aristocrates se retrouvent pour la première fois avec des gens de lettres et des philosophes dans un projet commun qui est celui précisément celui des Lumières.
Ces femmes sont à l’origine de ces réunions de société et de projets collectifs qui confèrent aux habitués une distinction désormais non seulement fondée sur la naissance. Leur objectif n’est pas de ceux auxquels les hommes peuvent ouvertement prétendre – la gloire, la renommée – mais bien l’éducation sociale et intellectuelle des femmes qui les animent.
Pour ces femmes, s’ouvre une sorte de carrière non rétribuée, qui exige de disposer d’importantes ressources financières. Dans ce domaine, les femmes se choisissent des modèles féminins : Anne de Bourbon, duchesse du Maine (1676-1753), pour Marie du Deffand, Claudine de Tancin pour Marie-Thérèse Geoffrin, cette dernière pour Suzanne Necker et pour Julie de Lespinasse.
Marie du Deffand et Julie de Lespinasse sont de ces salonnières qui entretiennent des correspondances faisant grossir le corpus d’écrits privés féminins. La seconde fut l’égérie des inventeurs de L’Encyclopédie – amie de Condorcet s’élevant contre l’esclavage, la tyrannie, l’obscurantisme, prônant la tolérance.
En même temps, dans ses lettres, elle choisit pertinemment de se livrer à la passion amoureuse.
La metteuse en scène Christine Letailleur a découvert et adapté les lettres adressées par Julie de Lespinasse (1732-1776) au comte de Guibert. Fascinée par cette littérature témoignant d’un caractère hors norme dans son temps, elle s’est penchée sur la vie de Julie : fille illégitime dont Mme du Deffand était la tante, et marquée par une enfance malheureuse. Son intelligence et son charisme font de son salon l’un des plus célèbres où dialoguent d’Alembert, Condorcet, Diderot.
Quarantenaire et loin de renoncer à l’amour et à la sexualité, comme le voudraient les moeurs de l’époque, consciente de son attrait et de ses convictions, elle s’éprend du comte de Guibert, de dix ans son cadet. Pour Christine Letailleur, l’héroïne n’aime pas selon les codes de l’époque : « Loin de la séduction, du libertinage, de la frivolité, de l’incontinence langagière, sa parole est sincère et profonde ». Entre raison et sentiment, elle choisit délibérément l’amour et entraîne le le spectateur dans l’intensité de la vie intérieure d’un être rare – larmes, folies et excès.
En juin 1772, quand Julie de Lespinasse rencontre Guibert, militaire en vogue et auteur d’un Essai général de tactique, elle tombe sous son charme, séduite par ses idées, sa réputation et son charisme.
Quelques années avant déjà, en 1766, trentenaire, elle avait aimé le marquis de Mora, plus jeune aussi de dix ans. Tuberculeux, il retournait dans son pays en Espagne pour ses soins ; durant l’une de ses absences, Julie rencontre Guibert : ils sont amants en 1774.
Les lettres révèlent une passion amoureuse dont la force la ravit, entièrement dévolue au sentiment qui, à la fois, l’accable et la réjouit, partagée entre la douleur d’aimer et son bonheur.
Le spectacle révèle sa chute et sa fin, elle ferme son salon et se retire du monde, se réfugiant dans la solitude pour vivre au plus près du sentiment et en mourir : regard sur les ultimes années de sa vie où elle aime absolument et infiniment « avec excès, avec folie, transport et désespoir ».
Votre promesse s’est-elle envolée ? Où êtes-vous donc ? Sur les routes de Prusse ? De Silésie ? De Russie ? A Dresde ? Déjà à Berlin ? Votre fantaisie de parcourir l’Europe vous a-t-elle fait oublier Mademoiselle de Lespinasse ? L’Europe a sans doute de plus grands attraits qu’une femme qui se languit de vous.
La pièce est un long monologue de tourments où la pensée de la protagoniste va et vient sans cesse, déplorant l’absence ou l’indifférence de l’aimé tout en se rétractant ensuite, et lui pardonnant, se reconnaissant encline aux reproches – capacités à troubler et blesser son amant.
Elle éprouve du remords pour la mort de Mora alors qu’elle est la maîtresse de Guibert. Serait-il mort avec ce doute et cette intranquillité d’avoir été trompé ? Elle lui écrit d’autant qu’elle est seule.
Se joue un ballet d’ombres qui se répercute sur les murs – silhouettes bien reconnaissables dix-huitième – l’ombre de l’amant défunt ou celle de l’infidèle épousant une jeune aristocrate fortunée.
Les tourments de l’âme conduisent Julie à souffrir physiquement et à « décliner ». Femme du XVIII è siècle, elle n’en appartient pas moins au romantisme et à l’introspection, à l’exploration de la vie intime avant la psychanalyse, pressentant dans ses malheurs d’enfance ceux qui l’accablent dans la maturité.
Sur la scène, l’héroïne de la passion amoureuse, entre aveux et confidences, est interprétée par l’élégance, la grâce et la réserve pudique de Judith Henry dont on entend les moindres pensées murmurées, entre autres, via la voie épistolaire révélée par la sonorisation de la plume d’oie qui gratte le papier sans fin, sur des écritoires disposés çà et là, surgissant des murs, tels des tiroirs.
L’actrice porte une robe magnifique, inspirée du portrait peint par l’artiste Carmontelle. Elle se tient droite, arpentant l’espace de son refuge, se mouvant, silencieuse, d’un côté ou de l’autre de la pièce dont les murs, comme pour les écritoires déjà cités, laissent surgir des chandeliers et leur bougie, petites niches apparaissant par magie, qui s’ouvrent ou bien se ferment comme des tiroirs encastrés.
Sans oublier la cheminée de côté dont les flammes dorées ne sont pas visibles, mais dont on entend le crépitement du feu de bois qui brûle – métaphore d’une douleur et d’une souffrance silencieuses qui dévoilent la grande solitude d’une passion d’incandescence mortelle.
A côté de la voix off du narrateur, se fait entendre celle de Guibert, portée par l’acteur saillant Alain Fromager, et celle du spectre de Mora dont le fantôme investit l’espace de sa présence mystérieuse – image d’une conservation secrète entre l’amante et l’ex-amant défunt- : Manuel Garcie-Kilian traverse avec allure la scène, composant activement un tableau en mouvement, tenant un chandelier à la main qu’il approche de son visage en protégeant la flamme qui tremble.
Dans la pénombre – celle du coeur féminin et de son isolement -, une large fenêtre éclaire la pièce de ses pans de lumière, parfois des ombres apparaissent sur l’écran du mur de lointain, les moments égrainés d’un débat implicite intérieur qui s’obscurcit peu à peu et se tend par la maladie.
La musique au piano interprétée et enregistrée par Lawrence Lehrissey balance entre extraits de l’Orphée et Eurydice de Gluck et les vagues sonores d’engourdissement ou bien d’emportement.
Un spectacle sur l’art et la douleur d’aimer qui appartient plutôt à la femme, elle qui ne possède toujours que très peu, reconnaissons-lui cela : ce geste existentiel, sublime et infini de survie.


DNA
Passionnée Julie de Lespinasse
Par