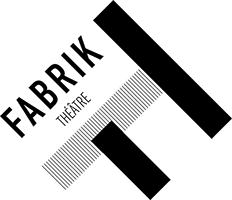Théâtre. »Baal » de Brecht: la vision funambule et crépusculaire de Christine Letailleur
Par Hugues Le Tanneur , publié le 25/04/2017 à 18H45
Stanislas Nordey excelle dans ce qui est considéré comme la première pièce de Bertolt Brecht. Donnant à son personnage une dimension presque aérienne, il entraîne la représentation dans un élan chaotique où, derrière la soif insatiable du poète prêt à tout expérimenter, se profile une détermination implacable. Une mise en scène d’inspiration expressionniste remarquablement tenue.
Son ombre se détache immense et difforme sur un panneau en fond de scène. « Baal est un géant », pourrait-on se dire parvenu à ce moment déjà bien avancé de la pièce. Mais ce n’est pas si simple. Cette tache sombre et mouvante dans un halo de semi obscurité alors qu’on entend sa voix tandis qu’il tente une fois encore de séduire une passante dont on aperçoit aussi seulement l’ombre donne peut-être la clef du personnage.
Baal est un géant mais c’est aussi un ogre, une bête immonde, un ange, un poète maudit et bien d’autres choses encore. Baal est une surface de projection, un fantasme, une image, un concentré, voire un cliché rimbaldien mâtiné d’une nuance de surhomme. Ce n’est pas pour rien qu’il porte le nom d’un dieu païen. Créateur et destructeur, il est à la fois l’éveil du printemps et l’appétit dévoreur. C’est pourquoi il séduit autant qu’il provoque. Pourquoi il attire et dérange.
Cynique et débauché, il se veut par delà bien et mal. Mais comme dans un film expressionniste son ombre inquiétante fascine et fait peur. Le fait-divers n’est jamais loin dans ce genre de ballade où un poète ivre danse et titube sur une arête saillante. Avec peut-être le secret désir de tomber – jusqu’où n’irait-il pas pour tester ses propres limites ?
De ce héros dionysiaque imaginé par le jeune Brecht qui signe avec Baal sa première pièce – une pièce à laquelle il ne cessera de revenir tout au long de sa vie –, les metteurs en scène ont livré ces derniers temps des versions plus ou moins convaincantes. On a souvent vu, par exemple, des Baal punks quand ils n’étaient pas directement inspirés d’Iggy Pop ou de Jim Morrisson, le chanteur des Doors. Christine Letailleur, quant à elle, oublie les poncifs de la culture rock pour explorer la complexité d’une figure dont la beauté est d’autant plus âpre qu’elle est pétrie de contradictions.
À cet égard le choix de Stanislas Nordey dans le rôle de Baal est des plus heureux. L’acteur – lui-même metteur en scène – est en effet un complice de longue date et a souvent joué sous sa direction, notamment dans la pièce Pasteur Ephraim Magnus de Hans Henny Jahn. On peut dire que sur le plan esthétique Christine Letailleur et Stanislas Nordey parlent le même langage tant leurs univers sont parents. Ce qui est un atout essentiel dans la réussite de ce spectacle, l’un des plus accomplis de Christine Letailleur.
En effet, même si l’ensemble de la distribution est irréprochable, la structure très particulière de la pièce repose principalement sur son personnage – et donc son acteur – principal. Sachant que, par ailleurs, cette structure, loin d’être uniforme, abonde en décrochages et ruptures de rythme où il s’agit de trouver l’énergie adéquate pour ne pas lâcher le fil, c’est bien sur les épaules de Stanislas Nordey que pèse la responsabilité de maintenir la tension indispensable. Ce à quoi il réussit fort bien par un subtil dosage d’opiniâtreté, entre vigueur et folle légèreté, donnant au personnage quelque chose d’insaisissable, qui évoquerait presque en exagérant un peu l’ange exterminateur du Théorème de Pasolini.
« Baal! Baal! », appelle sa mère, sans que jamais il lui réponde. Les autres aussi crient son nom. Toujours en vain. Cela semble avoir peu d’effet sur lui car, même entouré, il est toujours seul d’une certaine façon. Baal suit sa propre pente. N’en fait qu’à sa tête. Poursuit obstinément son expérience des limites, une bouteille de schnaps dans une main, tandis que, de l’autre, il fouille le giron d’une fille. Baal joue un jeu dangereux. Du bistrot au cabaret, puis à la fange, il n’y a qu’un pas.
Mais quelle que soit la situation, il y a toujours dans sa gestuelle ainsi que dans sa voix ce curieux mélange de détermination et de détachement de celui qui embrasse le tout de la vie avec les excès que cela suppose et pourtant en même temps semble se situer ailleurs, quelque part à côté du monde sans que l’on sache exactement où. La mise en scène extrêmement soignée avec ses effets d’ombres et un sens de la distance qui accentuent l’érotisme et le jeu légèrement stylisé des acteurs façonne un espace entre rêve et réalité aux antipodes du naturalisme mais parfaitement adapté à la langue abrupte pour ne pas dire brutale d’un jeune auteur déjà très inspiré.


Le Monde

Europe 1 / Le JDD
Baal : vie et mort d’un poète
13h14 , le 6 mai 2017
Qui est ce Baal, héros d’une pièce de jeunesse de Brecht ? Pour l’auteur, « il a le sérieux de la bête… » Et la pièce, mystérieuse comme son personnage, est l’histoire de sa vie, celle d’un personnage inspiré de Villon, de Rimbaud, poète sulfureux, mauvais garçon, provocateur, comme une incarnation du mal. Avant d’écrire pour le théâtre, Brecht avait écrit de nombreux, et magnifiques poèmes, et continuera à en écrire toute sa vie. C’est en 1918, à l’âge de vingt ans, qu’il écrit la première version de Baal, qu’il reprendra à plusieurs reprises, jusqu’en 1955, un an avant sa mort. La version choisie par Christine Letailleur est celle de 1919, traduite par Eloi Recoing. C’est la langue du poète qui est à l’honneur dans Baal et que fait entendre et soutient superbement la mise en scène.
L’errance d’un damné
Grand buveur, provocateur, séduisant toutes les femmes et refusant toutes les compromissions, Baal sème le malheur autour de lui et court à sa perte comme une force qui va. Entamée par une annonce scintillante de mille feux, la scénographie mouvante d’Emmanuel Clolus et Christine Letailleur dessine d’un trait sec les scènes au réalisme brutal, celles des bars et des rencontres, comme elle suggère l’univers mental de Baal à travers des ciels obscurs, des couleurs rougeoyantes, des nuits étoilées, des bruits de vent (lumières de Stéphane Colin et musiques de Manu Léonard). L’interprétation brûlante de Stanislas Nordey traverse la pièce, fait résonner les imprécations du mauvais ange : « Tous ne veulent que régner. Ce n’est pas de l’ambition. Rien que de la vanité. » Sont également remarquables Vincent Dissez, particulièrement incisif dans le rôle de son compagnon Ekart, et Youssouf Abi-Ayad dans celui de Johannes.


Les Inrocks

Télérama
“Baal”, le drame noir de Brecht illuminé par Stanislas Nordey
Fabienne Pascaud Publié le 07/05/2017. Mis à jour le 01/02/2018 à 09h01.
Puissante et provocante, la première pièce du maître allemand est portée par un formidable « prêtre halluciné du verbe » au théâtre de la Colline.
Comme souvent, l’ample scénographie d’Emmanuel Clolus est renversante. Avec la metteuse en scène Christine Letailleur, l’habituel complice de Stanislas Nordey a imaginé pour Baal, première pièce de l’Allemand Bertolt Brecht (1898-1956), un espace spectaculaire par sa nudité, ses clairs-obscurs, sa puissance de vides et de pleins composés par la seule lumière. Jusqu’à cette fascinante toile magma au début du spectacle et en fond de scène, sur laquelle s’incrustera peu à peu ce nom, « BAAL », en sataniques lettres de feu.
Poète maudit
C’est une sorte de damné luciférien, en effet, que le poète révolté et amoral ainsi nommé, ivre de sexe et d’alcool, que conçoit à l’âge de 20 ans l’insolent Bertolt. Sans doute sa fascination pour Rimbaud (1854-1891), le poète maudit, a-t-elle nourri ce personnage, et son admiration pour le Claudel de Tête d’or (1894) aussi.
Brecht est alors un provocateur iconoclaste, dont le verbe lyrique et énigmatique saura s’assagir au fil des événements, du nazisme à l’exil, via la guerre. Jusqu’à se faire bientôt engagé et didactique.
Pour lors, il flamboie. Et Baal, jeune poète surdoué qui refuse compromissions, lâchetés et conventions bourgeoises, opte encore pour la plus arrogante des libertés, le mal exterminateur et pas forcément rédempteur, lui ressemble sans doute comme un frère.
Ange déchu
Baal crée le malheur par sa seule présence perverse, irrésistible parce qu’intrépide, sulfureuse, audacieuse. Il est cet ange déchu et solitaire, bisexuel, que femmes et hommes rêvent de sauver. Il en profite. Les blesse tous et les humilie à mort. Sur le plateau simplifié à l’extrême où les personnages apparaissent-disparaissent comme sur une toile expressionniste d’Otto Dix, c’est Stanislas Nordey qui incarne ce mauvais génie jailli, en 1918, des horreurs de la guerre et d’une société lâche et corrompue.
Brecht remaniera jusqu’à sa mort ce drame noir, vaguement anarchiste. Christine Letailleur a choisi la version de 1919, superbement traduite par Eloi Recoing. Si la langue de Baal, mystérieuse et violente, emporte qui l’écoute dans des abîmes et des interrogations, le souffle qui s’en dégage porte haut. Vers le sauvage et la violence d’être soi. Baal est démesuré parce qu’il ne renonce à rien, n’a été laminé par rien. A peine éduqué. Juste livré aux mots. Qu’il manie en démiurge. Réordonnateur d’un langage à la puissance nietzschéenne. Il refonde le monde en le formulant.
Il fallait un prêtre halluciné du verbe pour porter flamme si incendiaire. Stanislas Nordey, au côté de son apôtre amant Ekart (Vincent Dissez, superbe), paraît consumé par son personnage, brûlant et brûlé. Il ravage et électrise l’espace autour de lui. Il est éblouissant, terrifiant. Et bouleversant.


Le figaro
La Chronique d’Armelle Héliot
24/04/2017
Baal, une pièce de théâtre extrêmement émouvante
CRITIQUE – Signé Christine Letailleur, ce spectacle est d’une force et d’une beauté bouleversantes. S’inspirant de Villon, de Rimbaud, Brecht dessine un personnage très attachant qu’incarne magistralement Stanislas Nordey.
Disons-le d’emblée, ce spectacle est l’un des plus émouvants qu’il nous ait été donné de voir cette saison. Il a été créé en mars dernier, au Théâtre national de Bretagne, est passé par Strasbourg et s’installe à la Colline à partir de demain pour tout un mois.
Baal est l’une des pièces les plus attachantes de Bertolt Brecht. Il en existe cinq versions, l’écrivain n’ayant cessé de la reprendre, de ses débuts, en 1918, alors qu’il n’a que 20 ans, jusqu’en 1955, un an avant sa mort.
Dans la traduction d’Éloi Recoing, cette dérive épique prend des éclats nocturnes impressionnants, accordés à la scénographie et aux lumières qui donnent quelque chose de fantastique à l’ouvrage. Christine Letailleur a choisi la version de 1919. La pièce est d’un sourd lyrisme, explosant en bouffées scintillantes, mais elle est prosaïque aussi, âpre, rapide, coupante comme une lame brillant sous la lune. Elle est née de la guerre.
Jamais on n’avait autant remarqué la présence de la nature et l’obsession du ciel que Brecht prête à son héros. Baal est son nom. Celui qui cherche un sens dans la voûte étoilée, celui qui bute, dans son errance terrestre, sur des obstacles divers. Baal est un poète et un voyou. Brecht s’est inspiré de François Villon, dit-on. Mais l’on pense aussi à l’homme aux semelles de vent, à Arthur Rimbaud. Passion d’être au monde, éblouissements de la vie, amour, sexe, alcool, brutalité virile, paroles jetées au vent, faiblesses d’enfant: la pièce est un peu comme un roman d’apprentissage qui finirait mal.
Christine Letailleur, metteur en scène toujours inspirée, orchestre les thèmes avec une douceur profonde, sans avoir peur de la violence que charrie l’ouvrage. Elle a le sens de la beauté, des mouvements, du mystère. Des ombres, des sons, des mouvements, des temps suspendus, des images fascinantes, énigmatiques, comme des moments clairs.
Aimant et odieux
Elle aime les comédiens et, ici, chacun, qu’il joue plusieurs rôles ou un seul, donne le meilleur de lui-même. Emma Liégeois, Vincent Dissez, Richard Sammut, belles présences, voix bien placées et articulations claires, servent à la perfection le propos de Brecht. Poétique, philosophique, politique, Baal nous parle au plus près, sans distance autre que celle de la beauté d’une langue.
Avec sa haute silhouette d’adolescent vite grandi, son allure un peu famélique, son regard lumineux, son visage ouvert à l’aventure, sa voix particulière, Stanislas Nordey est un interprète exceptionnel qui ne donne jamais le sentiment de jouer. Il est ce Baal en rupture, aimant et odieux parfois, fuyant toujours on ne sait quelle vérité sur lui-même qu’il ne veut absolument pas voir. Certaines scènes sont plus bouleversantes que d’autres. Celles avec la mère, notamment, et celles de la solitude, de l’abandon à la mort. Il y a dans Baal quelque chose de Woyzeck , quelque chose d’une tragédie du sacrifice.
hottello, le blog
Baal de Bertolt Brecht, traduction Eloi Recoing (L’Arche Editeur), mise en scène de Christine Letailleur
Veronique Hotte – hottello, le blog
Le jeune Brecht écrit Baal en 1918, une première œuvre dramatique qu’il remaniera en 1919, soit le joyau initial et brut d’une grande dramaturgie à venir qu’il ne cessera de retravailler jusqu’à une dernière version de la pièce en 1955, un an avant sa mort.
Il se proposait de parodier un drame expressionniste de Hans Johst, Le Solitaire, qui évoquait la déchéance d’un poète dont l’héroïsme tenait à une volonté de puissance.
Violence et cynisme du Baal de Brecht, qui cherche sans fin un échange constant avec le monde. : les êtres – hommes, femmes, taureaux -, mais aussi les éléments – le ciel par-dessus les toits à la Verlaine, ses nuages, ses couleurs et ses lumières.
Le monde étriqué ne satisfait plus cet ancien commis de bureau, amoureux de la vie.
Vitalité du héros, exaltation dangereuse, instincts d’autodestruction, vision romantique des travailleurs, buveurs et femmes légères de cabaret, le jeune Brecht ne construit pas encore une société nouvelle : Baal s’anéantit lui-même.
« Le vent pâle dans les arbres noirs ! … Vers onze heures vient la lune. Alors, il fait assez clair. C’est une petite forêt… Je vais sur des semelles de vent, depuis que de nouveau je suis seul dans ma peau… »
On ne peut s’empêcher d’évoquer le jeune homme de « Roman » d’Arthur Rimbaud qui sous les tilleuls verts de la promenade, « dans les bons soirs de juin », conte fleurette à une demoiselle via de jolis sonnets pour abandonner ensuite cet amour fugace, préférant de loin les bocks de bière des cafés tapageurs et les amis.
Baal est un poète incompris, apte à évoquer un été rouge, écarlate, sauvage, pâle et féroce, considérant la Nature comme la seule consolatrice des êtres indépendants et libres qui abandonnent systématiquement leurs proches après les avoir tant aimés.
Le ciel, ses lumières changeantes et ses vents, les rivières, les prairies et les forêts suffisent à cet homme insatiable que des appétits bestiaux tourmentent sans cesse : maîtresses, amants et schnaps à volonté, puis un détour recommencé sur le chemin de l’errance, jouant à cache-cache avec une mère éplorée – un écho de Peer Gynt.
Le désir – sexe et puissance – que maîtrise peu Baal le mènera au meurtre : le corps seul s’exprime au détriment de l’échange verbal, telle la condition de l’animal. Or, comment l’être peut-il se laisser autant envahir par des énergies destructrices ?
Désespoir, Baal est enfermé dans sa condition qui le lie à l’existence de la pourriture.
La mise en scène de Christine Letailleur, entre ombres nocturnes, lumières et théâtre d’ombres de boîte à musique XVIII é, installe des panneaux géométriques latéraux à cour et jardin avec portes et rideaux de scène rouges pour laisser entrevoir l’immense espace sombre. A cour, le cabanon d’un café tapageur avec ses clients.
A l’étage une coursive sous la lune que l’on atteint grâce à deux escaliers en colimaçon que les acteurs ne cessent de monter et descendre pour mieux marquer les obstacles existentiels, dessinant une ligne infernale de déplacement imposé.
Les comédiens et comédiennes ont la force requise pour hurler régulièrement au loup et à Baal, ce chenapan qu’ils poursuivent en vain et ne rattrapent jamais. Ils dessinent des figures attachantes dont la personnalité singulière affleure.
Ainsi, investissent la scène avec brio et pour le plaisir amusé du spectateur, Youssouf Abi-Ayad, Clément Barthelet, Fanny Blondeau, Philippe Cherdel, Manuel Garcie-Killian, Valentine Gérard, Emma Liégeois, Karine Piveteau, Richard Sammut.
Et Vincent Dissez interprète avec nuance et justesse l’ami musicien Ekart.
Quant à l’incarnation de Baal par Stanislas Nordey – metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg -, elle reste fascinante dans cette quête fuyante d’une présence existentielle qui vaille la peine, gourmande et charnue, entre jouissance active de l’instant et penchant enfantin à la contemplation méditative.
L’acteur porte le verbe poétique haut vers les étoiles, silhouette en déséquilibre, marchant comme en rêve, pas arrière et pas avant, tournant sur lui-même à la recherche d’un souffle d’amplitude, relançant à l’infini un bel élan intérieur grâce à une déclamation inventive, inscrite dans la puissance d’une voix qui pose le sens.


Mediapart
Christine Letailleur ouvre la poésie de « Baal »
PAR JEAN-PIERRE THIBAUDAT BLOG : BALAGAN, LE BLOG DE JEAN-PIERRE THIBAUDAT
Artiste associée au Théâtre national de Strasbourg auprès de Stanislas Nordey, Christine Letailleur le met en scène dans « Baal », une pièce du jeune Brecht dans sa version de 1919, la plus folle, traduite par Eloi Recoing. Une belle équipe d’acteurs au service d’une pièce ivre de poésie.
Baal ! Le double a n’est pas de trop. Il s’étire et se prolonge tout au long du spectacle. Il déchire la gorge de ceux qui aiment Baal sans retour : Emmi, la femme de son ex-employeur, la jeune Sophie Dechant, bien baisées, engrossées et mal aimées, d’autres encore, et son ami le musicien Ekart… Tous lancent son sombre nom dans la nuit obscure où ils vont, errants, souvent éperdus. Un long râle qui s’amplifiant vire au brame, âcre cri d’amour animal, Baaaaaaaaaal. Ces cris qui pleurent comme des larmes, Baal ne les entend pas, ou ne veut pas les entendre ; la gorge et le ventre lourds d’alcool, il va de l’avant à l’aveugle, les yeux fascinés par les couleurs du ciel, déjà ailleurs sans autre but que la nuit de l’ivresse pour mieux s’enfoncer dans l’ombre de la forêt aux odeurs faisandées, antre de la mort.
La poésie avant toute chose
Baaaaaaal… Cette plainte est aussi un chant, une complainte, une sale légende brodée d’or qu’il entretient de routes en estaminets. Un sale type, un misogyne, un bousilleur de femmes assurément, mais un être entier, sans compromis, sans faux-semblant. Un authentique poète. Ses visions sont celles d’un poète. Alors on lui pardonne tout. On l’appelle, on veut entendre sa poésie.
Ce que retient Christine Letailleur qui met en scène Baal de Bertolt Brecht, c’est d’abord cela : sa langue, sa poésie. Chantant l’amour : « Et l’amour est comme quand on laisse flotter son bras dans l’eau glacée d’un étang, avec des algues entre les doigts, comme le doux supplice devant qui l’arbre entonne son chant grinçant chevauché par le vent fou. » Chantant son désir de poésie : « Je veux faire naître quelque chose ! Je dois faire naître quelque chose ! Mon cœur bat à tout rompre. Mais parfois, assourdi comme les pas d’un cheval, tu sais ! La senteur des folles nuits de mai est en moi. » Chantant l’amour, l’ivresse et le ciel : « Je suis ivre et tu chancelles. Le ciel est violacé, à nous la balançoire, Malaga et Madère dans le ventre et le ciel est violacé. Je t’aime. »
C’est une pièce de jeunesse du très jeune Brecht en blouson de cuir, fasciné par l’écriture et la vie de Frank Wedekind dont Letailleur avait monté il y a quelques années avec maestria une pièce méconnue, Le Château de Wetterstein (lire ici). Brecht écrit Baal d’un jet à 20 ans, en 1918, peaufine la pièce l’année suivante puis la reprendra, la rabotera jusqu’en 1955 ; il mourra l’année suivante. Christine Letailleur choisit la version de 1919 superbement traduite par Eloi Recoing il y a dix ans pour la mise en scène qu’en donna alors Sylvain Creuzevault avec la troupe de sa compagnie D’ores et déjà aujourd’hui en partie dispersée. Le désir qu’a Christine Letailleur de monter cette pièce dans cette version-là est inséparable du choix de l’acteur qui en joue le rôle-titre : Stanislas Nordey, un acteur qu’elle a plusieurs fois dirigé.
La loi du marcheur
Le physique de Baal tel que le décrit Brecht dès la dédicace à son ami Orge est celui d’un type qui a passé la trentaine et est physiquement « plutôt gâté par la nature ». Et pas mal atteint, nous dira le timide Johannes : « Tes dents sont celles d’une bête : gris jaune, énormes, inquiétantes. » Ce n’est pas du tout le cas du maigrelet Nordey, jeune quinquagénaire racé, qui semble même avoir perdu quelques kilos depuis qu’il dirige le Théâtre national de Strasbourg, menant plusieurs vies en une. Ce qui les rassemble, c’est leur façon de muscler la langue. L’un dans l’écriture, l’autre dans la profération.
Nordey, ce grand amoureux des textes, aime détacher les phrases pour mieux les savourer, il en ralentit le débit pour mieux nous les faire entendre, et il accompagne cela d’une gestuelle des bras et des mains qui orchestre l’émission des mots. Le texte, le poème y retrouve son état naissant. Et comme Baal passe son temps à marcher sans trop savoir où il va, le poème s’invente en marchant et la pièce lui emboîte le pas, si je puis dire. L’ivresse et les femmes brouillent le jeu, non la poésie. Nordey, Letailleur et Baal ne font qu’un lorsque ce dernier proclame : « Je déteste l’exaltation romantique. »
Il y a du Alceste (Le Misanthrope), du Octave (Les Caprices de Marianne) et du Peer Gynt dans Baal, il y a surtout du Rimbaud dans ce Baal-là: Brecht avait dévoré sa poésie. C’est une époque où il écrivait des vers en pagaille, certains admirables. Lui aussi aurait pu écrire « Ô mes petites amoureuses, / Que je vous hais ! / Plaquez de fouffes douloureuses / Vos tétons laids ! ». Lui aussi s’est « baigné dans le Poème ». Baal rêve du Bateau ivre.
Le fantôme de la mère
Alors Letailleur pousse l’errance dans une nuit de plus en plus envahissante, peuplée d’ombres portées de plus en plus gigantesques (comme si la mise en scène devenait, elle aussi, sujette aux troubles de l’ivresse). Pas de décor où l’œil pourrait s’arrêter sur des détails, des objets, hormis la divine bouteille, mais des murs que l’on longe, des escaliers conduisant à une passerelle, une circulation incessante ponctuée par des arrêts aux auberges (un cadre sur le côté) ou au cabaret (un cadre de scène au fond) avec des ombres chinoises.
Le tenancier du cabaret, sentant la bonne affaire face au type désargenté, essaie d’acheter Baal en monnayant son originalité. Baal enverra tout balader, comme il l’avait déjà fait lors de la scène d’ouverture de la pièce dans un salon bourgeois où on le courtisait. La seule femme qui l’ébranle sans pour autant avoir prise sur lui, c’est sa mère. Dans la mise en scène de Letailleur, elle apparaît tel un fantôme, tenant une bougie à la main, de dos, sans visage, sans regarder son fils qui, lui, la regarde de biais, comme l’image d’une obsession, peut-être d’un remords, le seul.
Toute la distribution est au petit poil. L’ami Ekart, c’est Vincent Dissez (artiste associé au TNS) qui sait faire affleurer l’amour, y compris sexuel, qu’il porte à son ami, un amour réciproque ; un coup de couteau tend à le prouver. Johannes, c’est Youssouf Abi-Ayad, sorti de l’école du TNS tout comme Emma Liégois jouant sa fragile fiancée qui tombe sous le charme de Baal et n’y survivra pas, laissant son compagnon se noyer dans l’ivresse, doublure ruinée de son mentor. Sophie Dechant, c’est Karine Piveteau, sortie de l’école du Théâtre national de Bretagne, actrice fétiche de Simon Gauchet (lire ici). Emmi, la femme éperdue du chef de Bureau, c’est Valentine Gérard, venue de Belgique tout comme Fanny Blondeau, à la fois Louise la serveuse de l’auberge et Anna la dernière fiancée de Baal. Familiers des spectacles de Christine Letailleur, Manuel Garcie-Kilian, Philippe Cherdel et Richard Sammut se partagent les autres rôles avec Clément Barthelet.
Dernière salve de Baal traduite par Eloi Recoing : « Nous sommes libres, plus rien ne nous oblige. Nous pouvons par exemple dormir dans le foin ou bien à ciel ouvert… ou pas du tout. Nous pouvons nous promener. Nous pouvons chanter. Nous avons des rêves devant nous. Nous pouvons aussi ne pas y regarder de trop près. Ou pour mieux dire crever. »
La traduction d’Eloi Recoing vient de paraître à L’Arche Editeur, 96 p.